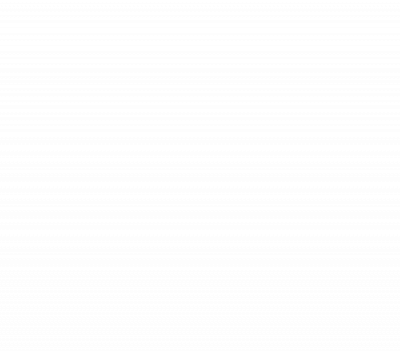Barbares !
La liesse suscitée par la victoire du PSG en ligue des champions a occasionné, durant les nuits du samedi 31 mai et du dimanche 1er juin, des débordements qualifiés de « barbares » par certains commentateurs et hommes politiques. « Barbare », c’est aussi le qualificatif dont usent nos opposants pour caractériser la chasse à courre. Mais que signifie donc ce terme ?
- • Barbare : qui manifeste de la cruauté, qui est inhumain (Larousse).
• Inhumain : qui ne semble pas appartenir à la nature ou à l’espèce humaine et qui est perçu comme atroce, monstrueux (Larousse).
S’il semble donc pertinent de qualifier de « barbares » les actes perpétrés en marge de la finale de la ligue, il n’en va pas de même de la vènerie.
La cruauté ? c’est placer un être vivant dans des conditions auxquelles sa nature ne lui permet pas de faire face (enfermer son chien dans une voiture en plein soleil, par exemple). Rien de tel en ce qui concerne la vènerie puisque l’animal chassé, objet de la poursuite des chiens prédateurs, a développé depuis la nuit des temps les capacités physiques et sensorielles pour leur échapper ; la preuve : trois fois sur quatre, il triomphe de la meute.
Inhumain ? c’est tout le contraire. Tout d’abord, l’humain s’est notamment élevé au sommet de la chaîne alimentaire car il est un prédateur, n’en déplaise à ceux qui voudraient nous voir tel un animal parmi les animaux, comme si une sorte de coexistence pacifique entre les espèces animales était possible ; en réalité, elles se mangent les unes les autres. Ensuite, parce que la capacité de conduire une meute de chiens, selon sa nature intrinsèque de prédateur, à la poursuite d’une proie en utilisant ses capacités olfactives et physiques relève d’une expertise qui réclame une intelligence proprement humaine. L’intelligence, cette capacité à relier les faits entre eux pour en déduire une connaissance rationnelle des situations que l’humanité a portée au plus haut niveau. Le veneur intelligent est ainsi celui qui, mieux qu’un autre, relie les événements du bien-aller pour déterminer la meilleure façon de servir les chiens dans la difficulté.
Alors, pourquoi cette erreur dans l’appréciation de la chasse à courre ? Pourquoi certains de nos contemporains, à l’instar de Brigitte Bardot déjà évoquée dans une précédente chronique, la qualifient de « monstrueuse » ? La réponse pourrait bien se trouver dans la question. La vie de nos « contemporains » se déroule majoritairement dans des espaces déconnectés de la « vraie » nature, où Pumba le phacochère est l’ami de l’enfant-lion ; dans la vraie nature, les lions comme les lionceaux et les lionnes mangent les phacochères.
Au fond, nos contemporains, trop connectés aux réseaux médiatiques – médiatique, qui est un intermédiaire, un lien mais aussi un filtre, un prisme entre le monde et nous – mais déconnectés de la vraie nature, imaginent un monde débarrassé de la mort. La leur d’abord, dont le traitement oscille entre l’isolement des vieux dans des Ehpad et une législation sur la fin de vie des humains qui tend à faciliter son accélération ; celle de tout le règne animal ensuite. Etrange paradoxe d’ailleurs puisque, simultanément, nos parlementaires étudient la possibilité d’accélérer la fin de vie des humains tout en proscrivant l’euthanasie des animaux ; il est vrai que cette dernière proposition émane du député Aymeric Caron dont on connaît les foucades.
Et pourtant, s’il est encore possible dans nos sociétés de cohabiter avec des espèces animales sauvages dont certains sujets dépassent les 200 kg, c’est parce que les chasseurs régulent leurs populations, alliant les plaisirs de la chasse à une mission de service public réalisée gratuitement.
La vènerie n’est donc pas barbare. La bataille des mots est essentielle dans notre combat face à l’obscurantisme animaliste. N’en laissons pas l’exclusivité à nos opposants.