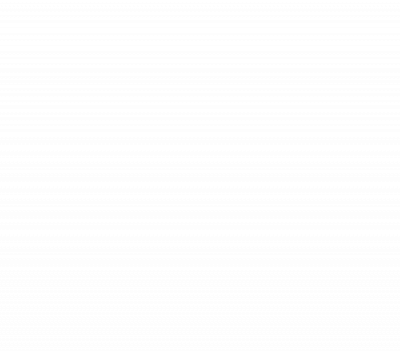Pourquoi chasse-t-on ?
Comment justifier la mort d’un animal sauvage autrement que par l’indispensable régulation de sa population ? Que faire face à ceux qui récusent aujourd’hui jusqu’à l’existence même du chasseur ? Rien, sans doute, tant notre société rejette avec violence ce qu’elle refuse de voir ou d’accepter. Sujet clivant, la chasse fait l’objet d’un long procès en sorcellerie où s’épuisent ses défenseurs et ses détracteurs, sur fond de spécisme et d’antispécisme, d’écologie hors-sol, de ruralité en crise, de morale et de radicalité politique.
Dans le canton de Genève, en Suisse, où l’on s’enorgueillit de l’avoir interdit, les autorités ont fini par engager des « Gardes-Faune » payés par le contribuable pour contrôler l’explosion du grand gibier. En Hollande, pris souvent comme exemple des bonnes pratiques écologiques, des fonctionnaires gazent chaque année des milliers d’oies épargnées en France au nom de la protection des milieux agricoles. En Afrique, dès que la chasse n’est plus encadrée, le braconnage s’installe même dans les réserves les mieux protégées, comme au Kenya ou en République démocratique du Congo.
La moralisation des équilibres naturels, le refus obstiné de la mort, le rêve dangereux d’une nature sans hommes et l’explosion des cultures urbaines, associés à une étrange logique à la fois technocratique et compassionnelle, ont fini par forger une image désincarnée du monde sauvage où les espèces sont désormais classées selon des critères anthropomorphiques et souvent fictionnels. Le faon est mignon, l’ours balourd, le loup inoffensif, le lion majestueux, la hyène cruelle, le vautour sans pitié et le phacochère jovial… Au mieux l’on s’accorde pour laisser le droit de chasse aux derniers peuples autochtones de la planète. Au pire on rêve à sa disparition pure et simple, au profit d’une forêt idéale et essentialisée dont l’homme, foncièrement mauvais, doit impérativement être exclu.
Pourtant, quand José Ortega y Gasset publie Sur la chasse en 1942, « la chasse n’est pas considérée comme une chose sérieuse », mais comme un passe-temps, un loisir ou une simple distraction, entre bonheur au sens philosophique, plaisir, nécessité, raison et atavisme. Un univers complexe, profane et sacré, où s’entremêlent à l’infini la morale et l’immoral, la violence et ce qui la canalise, la société et la sauvagerie. Le philosophe, qui n’est pas chasseur, s’efforce de confronter les passions cynégétiques avec ce qu’il sait de l’Humanité. Les modes de chasse – vènerie, approche, piégeage, fauconnerie – le grand ou le petit gibier tout comme les armes utilisées le passionnent bien moins que ceux qui s’y adonnent ou les utilisent. Il n’est ni pour ni contre. Il ne juge ni ne condamne, mais cherche du sens. Sa force est son universalisme. Il nous entraîne dans la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge et le Monde Moderne et fait s’entrechoquer les peintures rupestres de la grotte d’Altamira avec la course folle de Dionysos. Il raconte la battue mieux que ne le ferait un traqueur. Il est à la fois le cerf et celui qui le tue, la forêt et la meute qui la force. La tête froide, il convoque l’Histoire et les arts, en appelle à Nietzsche, à Washington Irving, à Descartes et à La Chronique latine des rois de Castille. Sensuel, précis, instinctif et érudit, Ortega analyse la grande mécanique qui se déroule devant ses yeux. Il fait sienne l’émotion de l’approche, la tension joyeuse des chiens, le plaisir de la traque et la mise à mort pour mieux les mettre en abîme. D’un revers de la main, il renvoie dos à dos les opposants à la chasse et les chasseurs eux-mêmes, tous deux dépassés par l’ampleur du rituel immémorial qu’ils perpétuent chacun à leur manière sans vraiment le comprendre. Car la question n’est plus ici de savoir s’il faut chasser ou non, mais de saisir comment et pourquoi la chasse a fait l’Homme. Bien sûr, libre à chacun de le nier. Le philosophe n’est pas un moraliste et ne cherche nullement à convaincre. Mais son raisonnement est implacable. Oui « le chasseur est porteur de mort » mais il offre sans doute à la nature l’éthique et la dignité qui lui font tant défaut. Pour lui, « la chasse n’est pas quelque chose qui arrive à l’animal par hasard car dans les profondeurs instinctives de sa nature il a déjà prévu le chasseur ». Et de fait, ce jeu de prédation qui unit le chasseur à sa proie a aussi quelque chose de liturgique et de spirituel. Chaque geste compte. Chaque respiration est pesée. Le corps tout entier est tendu. La chasse n’est pas une pulsion, mais un acte de raison d’une légitimité bouleversante. À l’opposé de la guerre, elle est sans cruauté et obéit à des règles très strictes assurant l’abondance du gibier qui procure au chasseur la nourriture et la vie.
Il faut lire et relire Sur la chasse. Ce texte essentiel n’a aujourd’hui rien perdu de sa vérité. Il y apparaît en pleine lumière la folie qui nous a conduits à mettre les hommes d’un côté et la nature de l’autre ! À rebours, il nous plonge dans une passion paradoxale et retend ce lien si fragile qui unit l’homme à l’animal… jusqu’au drame.
Préface du livre « Sur la chasse » de José Ortéga Y Gasset, publié aux Éditions Atlantica | Photo : Jérôme Morland, Objectif Vènerie